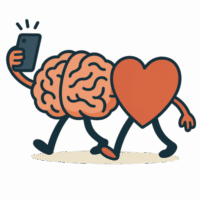« Citoyens, je vous en prie, réfléchissez-y : est-ce qu’on apprend à penser comme on apprend à croire ?
Croire, c’est ce qu’il y a de plus facile. Et penser, c’est ce qu’il y a de plus difficile au monde. »
(Ferdinand Buisson 1841-1932)
Au-delà des évidences et de leurs apparences, le rôle de la science est de rechercher les arguments objectifs permettant de vérifier dans quelle mesure nos observations reflètent la réalité. Il ne s’agit pas de prétendre accéder au réel, mais de produire des hypothèses et des représentations (modèles) qui nous rapprochent de la réalité. Ces théories ne sont jamais définitives et doivent guider l’expérimentation qui leur permettra de continuer à évoluer. Georges Canguilhem qualifie l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, de Claude Bernard, de « long plaidoyer pour le recours à l’idée dans la recherche, étant entendu qu’une idée scientifique est une idée directrice et non une idée fixe. » Cette complémentarité des deux outils que sont l’observation, qui cherche à établir des faits, et la théorie, qui cherche à prédire des faits, constitue le fondement de la démarche expérimentale.
Le chimiste M-E Chevreul (1856) décrit en des termes proches cette recherche de “la vérité” : « Un phénomène frappe vos sens ; vous l’observez avec l’intention d’en découvrir la cause, et pour cela, vous en supposez une dont vous cherchez la vérification en instituant une expérience. Le raisonnement suggéré par l’observation des phénomènes institue donc des expériences (…), et ce raisonnement constitue la méthode que j’appelle expérimentale, parce qu’en définitive l’expérience est le contrôle, le critérium de l’exactitude du raisonnement dans la recherche des causes ou de la vérité ».
« l’esprit de l’observateur doit être passif,
Claude BernarD
c’est-à-dire se taire » …
«Quand on fait des recherches il faut avoir une hypothèse en tête.
Sans cela, on marche à l’aventure.
Ce n’est pas avoir une idée préconçue :
c’est seulement avoir un plan »
Selon Claude Bernard, il faut donc savoir douter mais cela ne signifie pas être sceptique : la démarche scientifique s’ancre dans la confiance. La rigueur procède du doute : chercher des raisons de douter plutôt que des raisons de croire, c’est valider et s’appuyer sur un ensemble de procédures reproductibles, appliquées avec soin et constance…
Le réalisme naïf et l’illusion de corrélation
Le réalisme naïf et l’illusion de corrélation constituent les deux principaux écueils à notre appréhension de la réalité.
L’impression première que nous offrent nos systèmes perceptifs est que nous percevons le monde extérieur tel qu’il est. Nous identifions les contenus de notre perception aux objets perçus. Nous avons donc tout simplement l’impression de percevoir la réalité, alors que nous n’avons réellement accès qu’aux impressions que produit le monde sur nos récepteurs sensoriels et aux sensations que nous construisons à partir de ces signaux corporels. Cette illusion de percevoir la réalité est dénoncée depuis Aristote et dénommée Réalisme naïf par les philosophes. Dans le contexte scientifique, cette illusion peut constituer un obstacle à notre capacité de concevoir des expériences pour vérifier ce que nous percevons comme une évidence (ex : le soleil tourne autour de la terre). Dans le contexte de la communication, l’impression de percevoir la réalité telle qu’elle est constitue un obstacle à notre capacité de prendre en compte le point de vue d’autrui. Cette illusion de percevoir la réalité est solidement étayée par d’autres biais cognitifs que sont par exemple les illusions d’objectivité ou de rationalité.
Notre pensée est également soumise à la détection de coïncidences : nous sommes sensibles aux évènements synchrones, et générons automatiquement des associations causales. De la même façon que nous croyons percevoir le réel, nous croyons facilement percevoir directement des relations causales.
Un exemple courant de cette illusion de corrélation est apporté par l’idée que les accouchements plus fréquents les jours de pleine lune. Cette conviction ne possède aucun fondement scientifique sérieux (cf. http://lazarius-mirage/lune) n’a jamais été étayée par des statistiques sérieuses (ex : Rossetti 1990) mais continue d’être irrésistiblement très en vogue dans les maternités et le grand public.
Les associations positives (ce soir nous avons beaucoup de naissance et c’est pleine lune!) étant plus marquantes que les négatives (soir de pleine lune sans abondance de naissance, ou abondance de naissance sans pleine lune), elles dominent dans l’impression globale et contribuent donc à générer ou entretenir une idée fausse (cf. la famille des biais de confirmation et de filtrage).
Et bien évidemment nous transformons trop facilement la coïncidence en causalité : nous cherchons à comprendre le monde en lui donnons du sens. Le hasard n’étant pas toujours porteur de sens, nous avons tendance à le remplacer par des croyances.
L’illusion de corrélation consiste à percevoir une relation entre deux événements non reliés ou encore à exagérer une relation qui est faible en réalité. Par exemple, l’association d’une caractéristique particulière chez une personne au fait qu’elle appartienne à un groupe particulier alors que la caractéristique n’a rien à voir avec le fait qu’elle appartienne à ce groupe. La démarche expérimentale a pour objectif de prolonger l’observation en soumettant l’hypothèse qu’elle a fait naître à la vérification par une démarche qui cherche à établir la relation causale soupçonnée.